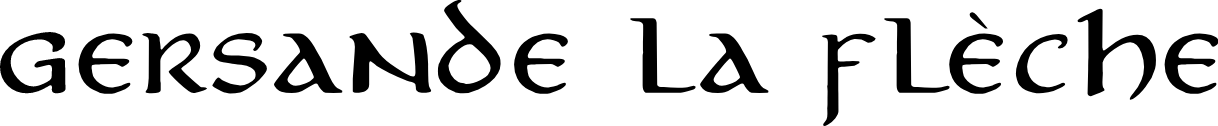Le privilège des petits inconforts parfaitement ordinaires
J'écris sur la douleur chronique aujourd'hui, parce que les six derniers mois ont été marqués par de très grands changements.

Depuis six mois, je travaille vraiment fort pour comprendre comment la douleur se manifeste et traverse mon corps. C’est quasiment un travail à plein temps pour suivre la montagne russe des mes humeurs, mes petits bobos, mes sensibilités — j’ai deux bullet journaux (et demi!) pour le prouver. Je suis désormais sur des médicaments qui ont concrètement et pas mal miraculeusement baissé mes niveaux de douleur quotidienne, et je suis arrivé∙e à un point où je commence lentement à (re)découvrir toutes sortes de petits inconforts et sensations intéressantes.
Par exemple, j’ai appris cet automne que quand mes métatarses et mes orteils me dérangent, ça veut dire que mes pieds ont froid. Ou quand j’ai de l’inconfort dans mon cou et derrière ma mâchoire, c’est un signe qu’il faut que je pointe mon menton vers ma poitrine, pour créer de l’espace autour du nerf écrasé dans mon cou. Quand j’ai mal au ventre, c’est un rappel à regarder l’heure. Tôt dans la journée, c’est souvent un signe que je suis assez éveillé∙e pour manger. Tard dans la journée, c'est plus souvent un signe d’anxiété, et je dois m’assurer d’éviter de boire ou de manger des aliments aigres. Quand l’intérieur de mes genoux me dérange, c’est un petit rappel que ma posture sur mes pieds plats doit changer pour réaligner mes genoux. Si c’est la partie en haut de mes genoux qui me font mal, souvent c’est un signe que mes genoux ont assez travaillé pour une journée — avec un peu de chance, ça m’arrive à une heure où je peux aller m’allonger. Quand je ne ressens plus de sensation, ou bien une sensation de picotement, dans mes troisième et quatrième doigts, c’est une indication que quelque chose est en train de serrer mon nerf ulnaire dans mon bras droit, et que je dois créer de l’espace dans mon cou et mon épaule avec des mouvements doux de mon bras. C’est comme si j’ai existé pendant quinze ans au fond d’une fosse abyssale, et mon corps s’était ajusté à une compression lourde, oppressive et omniprésente. Après tout ce temps recroquevillé, j’ai vraiment dû réapprendre comment dérouler mon corps de façon consciente. Consciente, parce que mon subconscient est programmé pour un véritable déluge qui s’est retiré (pour le moment). Au cours des années, mon corps a perdu ses repères lorsqu’il s’agit de répondre aux petits signaux voyageant sur les voies nerveuses de mon corps. Alors je dois le faire consciemment, me souvenir que je peux créer un peu d’espace dans mes articulations, dans mon dos, de respirer profondément et (faire semblant de) croire que cette fois oui, la douleur sera passagère. La douleur est un passager sur mes nerfs, m’apportant des informations utiles. Je réapprends à donner mon attention aux petits inconforts parfaitement ordinaires.
Il y a six mois, toutes ces sensations m’étaient complètement invisibles. La seule information que m’apportait mes nerfs était l’alarme de DOULEUR DOULEUR TU AS DE LA DOULEUR, sans distinction ou sensation pour me guider. Déchirante, diffuse, erratique, lancinante, irradiante: voici le beau vocabulaire qu’on me suggérait le plus souvent pour décrire ma douleur, et j’étais incapable de les dissocier. Pendant des années, chaque fois que j’essayais de me porter à l’écoute de mon corps, tout ce qui me parvenait était DOULEUR DOULEUR TU AS DE LA DOULEUR. Un vacarme assourdissant qu’on ne peut jamais éteindre, la douleur réussissait à me rejoindre dans mes rêves pendant que je dormais. Après un bout, tu n’entends plus rien du tout. C’est une existence corporelle embrouillée et douloureuse à l’extrême. Et quand tu tombes encore une fois à l’urgence parce que tu n’arrives plus à bouger ton bras ou tes jambes, et une travailleuse de santé te demandes de décrire où ta douleur se situe sur une échelle de 0 à 10, tu sais que si tu donnes un chiffre plus élevé que 7 que ça ne suscitera que de la méfiance. Alors tu le donnes un 6 (ou peut-être un 7, si la travailleuse te semble particulièrement bienveillante), et tu pries qu’on t’aidera.
Je ne sais pas si cette rémission va durer. Je ne sais pas si la douleur comme avant va revenir. Je ne sais pas si les médicaments que je prends vont continuer à bien jouer ensemble. Je ne sais même pas si le diagnostic provisoire qu’on m’a donné en septembre est le bon. Des douzaines de médecins m’ont donné des douzaines de diagnostics à travers les années, c’est presque farfelu. J’essaie surtout de ne pas penser à ce qui va se passer si le médicament pour gérer ma douleur générale arrête d’être efficace. Surtout quand j’ai une imagination très informée par le vécu. Mais j’ai aussi très peur d’espérer que cette rémission grâce aux bons médicaments sera permanente. Déjouer la peur de l’espoir n’est pas un simple défi.
Au moins, pour le moment, j’ai de quoi m’occuper: réapprendre ces petits inconforts parfaitement ordinaires.